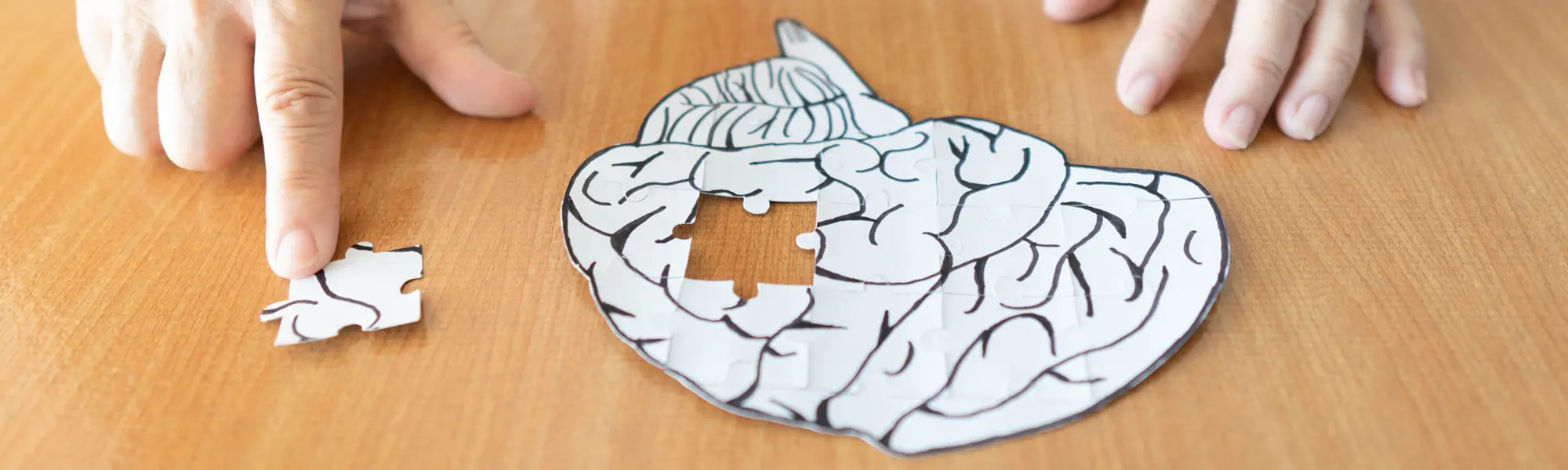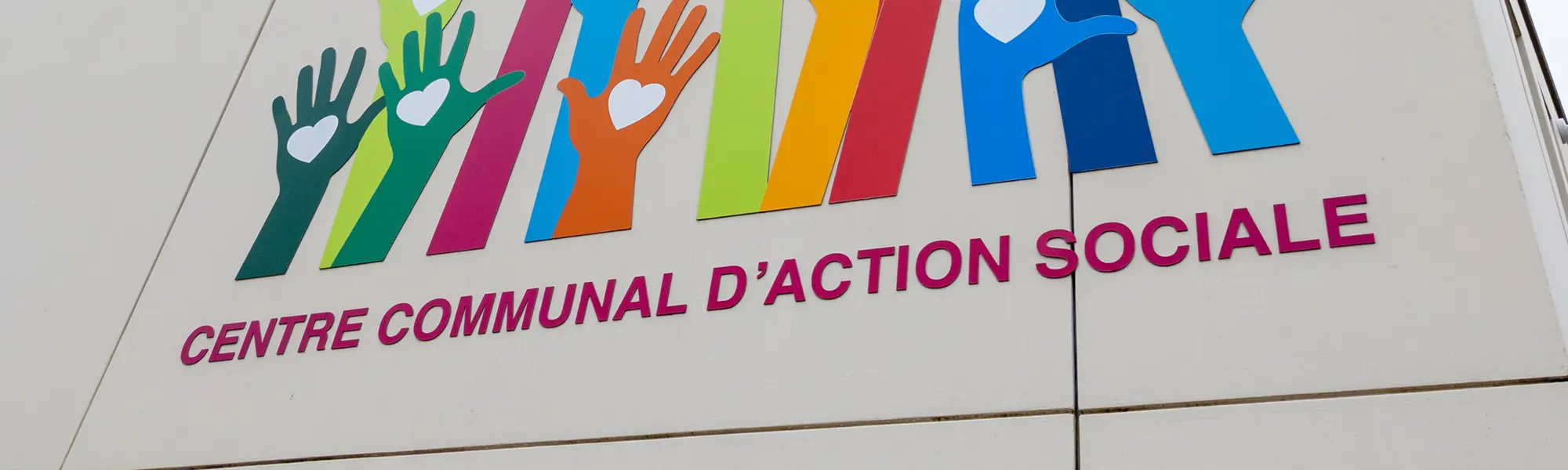Les services à domicile pour les personnes en perte d’autonomie : mode d’emploi
Faire appel à un service d’aide à domicile pour faire les courses, préparer les repas ou assister dans les gestes de la vie quotidienne peut permettre à une personne âgée ou en situation de handicap de rester plus longtemps à domicile. Comment trouver, choisir, et gérer la relation avec les aides à domicile ? Nos réponses.
De quels services votre proche a-t-il fondamentalement besoin ? À quel(s) professionnel(s) faire appel et comment les rémunérer ? Auprès de qui vous renseigner pour trouver ces aides à domicile, les financer, et vous assurer que tout se déroule bien ? Toutes les réponses dans ce guide complet.
Quels sont les différents services à domicile dont une personne âgée ou en situation de handicap a besoin ?
Lorsqu’une personne ne peut pas (ou plus) accomplir seule les actes simples de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, préparer ses repas…), elle peut recourir à une aide à domicile, assistant(e) de vie ou auxiliaire de vie sociale. Une prise en charge de ce type peut être précédée par une évaluation de ses besoins avec elle et, le cas échéant, avec son entourage.
Les tâches purement domestiques
Un premier niveau de services à domicile regroupe des services “de base”, qui peuvent être assurés par tout type d’intervenant du secteur des services à la personne (et pas toujours liés à une perte d’autonomie, mais parfois à un besoin de confort) :
- Le ménage et l’entretien du domicile (bricolage, jardinage…),
- L’hygiène et le bien-être (lessive et repassage, esthétique, coiffure, pédicure et manucure…),
- L’alimentation (livraison de petites courses, préparation ou portage de repas…),
- Les menues démarches (poster un courrier, aider à le rédiger…),
- Le soin d’un animal de compagnie (promenade, toilettage…).
Les actes essentiels de la vie quotidienne
On entre ici dans un 2e niveau de services à domicile, souvent plus “intimes”, et qui demandent des intervenants spécifiquement formés pour accompagner les personnes en fonction de l’étendue de leur perte d’autonomie :
- L’hygiène intime (se laver, aller aux toilettes…),
- L’aide à la prise des repas,
- L’aide aux déplacements (véhiculés ou à pied),
- L’habillement (se vêtir ou se dévêtir),
- Les transferts (se lever, se coucher, quitter son fauteuil…),
- La surveillance, à distance ou grâce à des gardes de jour ou de nuit.
Les soins physiques et psychologiques
Les professionnels des services à domicile ne sont pas des soignants : ils n’ont ni les compétences, ni le droit de dispenser de “vrais” soins médicaux.
Sous certaines conditions, il peuvent néanmoins “relayer” les services de soins à domicile, en :
- veillant à la bonne prise des traitements préparés par les soignants,
- assurant une surveillance et en alertant les soignants si nécessaire,
- offrant une présence et un soutien psychologique.
À qui faire appel pour assurer les services à domicile ?
Les professionnels de l’aide à domicile
Dans le jargon consacré du soutien aux personnes en perte d’autonomie, on parle “d’aides humaines” pour désigner tou(te)s les professionnel(le)s qui vont se déplacer à domicile pour dispenser les services nécessaires.
Dans le détail, on distingue 2 types de profils :
- l’aide à domicile, sans diplôme particulier nécessaire (même si un CAP est généralement le minimum recommandé, et que le BEP sanitaire et social, mention “aide à domicile” est de plus en plus répandu) ;
- l’auxiliaire de vie sociale ou assistant(e) de vie aux familles, qui a décroché un diplôme spécifique (le Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou DE AVS, le Diplôme d’État accompagnement éducatif et social ou DE AES, ou encore le Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles, TP ADVF), diplôme qui l’autorise à aller plus loin dans l’accompagnement proposé.
Les modes de contractualisation
Pour employer un(e) professionnel(le) des services à domicile, vous avez le choix entre 3 modes de contractualisation : l’emploi direct, le service prestataire et le service mandataire.
Voici un tableau comparatif de ces 3 solutions pour bien en comprendre les principales différences :
Comment trouver les intervenants et organiser les services à domicile ?
Rémunérer une aide à domicile : zoom sur le Chèque emploi-service universel (Cesu)
Le Cesu est un titre de paiement émis par l’Urssaf, qui permet :
- de régler les prestations d’aide et de services à la personne à domicile,
- d’effectuer les déclarations de salaire pour s’acquitter plus facilement des charges sociales.
Il existe 3 formes de Cesu :
- le Cesu déclaratif (c’est vous qui effectuez, sur internet ou via un volet social imprimé, les déclarations d’heures travaillées par vos employés à domicile) ;
- le Cesu préfinancé (en partie ou en totalité) par un organisme public, votre institution de retraite complémentaire, votre mutuelle, votre propre employeur… ;
- le Cesu tiers-payant, un Cesu préfinancé accordé dans le cadre d’une aide financière comme l’Apa ou la PCH.
Pour évaluer vos besoins et les solutions : le rôle-clé des organismes locaux
Quel(le)s aide(s) sont vraiment nécessaire(s) à vous (ou votre proche) ? Combien d’heures par semaine ? Avec quel type d’intervenant ? Pas simple à établir, et encore moins à mettre en place !
C’est pour cela que les organismes d’aide à la préservation de l’autonomie jouent un rôle-clé : ils sont capables de vous informer sur les services à domicile présents localement, de vous orienter en fonction de vos besoins, voire d’organiser et d’évaluer eux-mêmes les prestations.
Sur l’ensemble du territoire français et outre-mer, vous pourrez faire appel :
- au CCAS (opéré par votre commune ou communauté d’agglomération),
- au Clic (présent généralement avec plusieurs antennes dans le département),
- au Dac, qui se focalise davantage sur les besoins les plus complexes, et qui intègre notamment les Maia, des dispositifs conçus à l’origine pour les malades d’Alzheimer et de troubles apparentés.
Choisir son intervenant (ou son prestataire)
Comment choisir le bon intervenant ? Après avoir fait le point complet sur vos besoins, choisi entre emploi direct ou services prestataire et mandataire, il vous reste :
- à établir une liste d’intervenants potentiels,
- à les rencontrer, avec votre proche (si vous êtes aidante(e)), afin d’éviter un refus d’aide de sa part.
Pour vous aider dans vos recherches, sachez que le Cesu tient à jour un annuaire des prestataires de services à domicile.
Mobiliser les aides financières
Indispensables pour le maintien à domicile, ces services représentent toutefois un budget important. Voire prohibitif. Obtenir une aide financière à l’autonomie va donc souvent s’avérer essentiel pour boucler votre budget.
Pour une personne âgée : Apa ou Plan Oscar
Pour les personnes en Gir 1 à 4 (avec donc une perte d’autonomie avérée), l’Apa (Allocation personnalisée d’autonomie) “à domicile” est l’aide financière toute indiquée pour financer les services à domicile.
Lorsqu’on est encore autonome (Gir 5 ou 6), le Plan Oscar de l’Assurance retraite représente une bonne alternative.
Dernière option : l’ARSM ou aide-ménagère, accordée par le département, pour financer des services d’entretien du domicile.
Pour une personne en situation de handicap
À demander auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), la PCH est la principale aide dédiée aux personnes en situation de handicap. Via notamment son volet “aides humaines”, elle est toute indiquée pour financer les services à domicile.
Pour les personnes à faibles revenus, l’AAH (Allocation aux adultes handicapés, et en particulier sa Majoration pour la vie autonome), offre un complément de revenu bienvenu.
Enfin, l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) va permettre de mettre en place les services nécessaires pour les mineurs en situation de handicap.
Pour tous : le crédit d’impôt pour les aides à domicile
Dernière aide disponible pour faire baisser la facture : le crédit d’impôt sur les services à domicile, correspondant à la moitié des sommes dépensées en remboursement par le Trésor public (avec des plafonds selon votre situation).
Organiser les interventions des services à domicile
Les intervenants et prestataires sont choisis ? Les contrats signés ? Les horaires convenus ? Tout n’est pas forcément réglé pour autant : le secteur des services à la personne manque en effet de “bras”, une aide peut manquer un (ou plusieurs) rendez-vous, le service ne pas être au niveau de qualité attendu… Bref : il faut surveiller, et si besoin agir en cas de souci.
Tous nos articles sur cette thématique